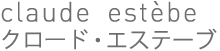ウチマタ / Uchimata
Par Olivier Massé
Pourquoi photographier des jambes ? Quand le photographe se fait explorateur à la rencontre des races humaines, ce qu’il nous livre à la fois de différence et de proximité peut-il nous être révélé par des images de cette région des corps ?
Une fois passé le premier contact, visuel, de la différence des traits, de la couleur de peau, de ce qu’il y a d’évidemment différent selon les peuples et les latitudes, n’est-ce pas les attitudes du visage qui dévoilent un invariant du peuple des humains ? Dès le premier âge, nous savons tous lire la joie, la peine, l’inquiétude, la surprise ou l’interrogation qui nous font reconnaître « un autre » au-delà du masque de la face. Voilà une donnée universelle établie, depuis peu, mais sans aucun doute définitivement, par les anthropologues. C’est probablement pour cela que, quelque soit la manière de faire passer à l’objectif les traits des faces humaines, in fine, les photographes qui en ont fait leur champs d’exploration, en nous montrant leurs singularités, ne font jamais que mettre en relief l’évidence d’une commune nature humaine. Et pourtant…
En passant par le Japon – et cela ne manquera de contraster avec la France – l’oeil est souvent arrêté par le peu de prise que la tendance unisexe a pu avoir. Pantalon ou jupes, vêtues ou dévêtues, chaussettes courtes, longues ou très longues, plus que de l’assumer, on peut penser que c’est à une mise en avant de leur féminité que se livrent les femmes japonaises. Ce pourrait être un premier trait différentiel. Mais il ne serait qu’anecdotique. Dans le fond, bottées ou dévêtues, continuité d’un uniforme ou épousant l’extravagance d’une mode ou d’un style, rien ne saurait permettre, a priori, de distinguer une paire de jambes photographiée, dans un pays ou un autre… Rien ?
Si l’on ne voyait de l’image que l’objet, si d’un corps saisi à la volé par un objectif photographique on ne considérait que ses formes et son apparat, on ne pourrait reconnaître ce qui distingue l’universel, la morphologie, et le singulier, c’est-à-dire l’inspiration ou le goût des personnes. Un invisible peut être perçu dans l’image dès lors qu’on scrute au-delà du cliché.
Devant les photos de Claude Estèbe, une fois passé l’effet pop ou saugrenu ou érotique de chaque image, la série des uchimata nous invite à considérer un interstice – délicat et pourtant irréductible – qui se tient entre l’universel et le singulier, et qui donne un sens précis au mot de « culture ».
Exotiques, érotiques ou urbaines, ne retenir que ces effets que peuvent porter en elles les photos de la série des uchimata serait manquer le propos photographique de l’artiste. Regarder ailleurs, non plus du bas vers le haut, pour voir autrement, c’est le geste de Claude Estèbe qu’il nous invite à reproduire si l’on considère l’ensemble de la série.
Car, s’il s’agit de poses, aucune de ces photos n’est jamais posée : ce sont des clichés pris à la volée, instant saisi dans le mouvement incessant de la vie des Japonaises au quotidien. Et ce que nous voyons alors – magie que permet l’appareil photographique quand il suspend le défilement du temps – c’est qu’aucune de ces postures n’est stable. Tels des danseurs photographiés en plein mouvement, il semble que les jambes saisies par Claude Estèbe s’intègrent dans un ballet, quand bien même le corps est à l’arrêt, quand bien même les personnes sont en attente. C’est là que le contraste saisit : la plasticité des postures, les contorsions, les équerres ou les parallèles inversées, les angles convexes dessinés par les pieds exhibent une façon d’habiter son corps manifestement inconnu des Occidentaux.
Si le corps a son langage et s’exprime dans les postures et les distances qu’il entretient avec d’autres corps, alors il n’y aura rien d’étonnant à ce que, de l’étrangeté ressentit par les propos que tiennent les postures photographiées par Claude Estèbe, on devine une langue étrangère, une corporéité spécifique, – celle du seul pays, je crois, où l’on peut voir aussi ordinairement cette façon si particulière de se tenir.
Les « pieds en dedans », traduction bien maladroite des dictionnaires qui ne savent pas rendre compte de la charge esthétique – et donc sémantique – propre à chaque aire géographique. Car tandis que la danse classique aura au fil des siècles occidentaux valorisé le port altier, le pas léger et l’envol vers les cieux divins, les frottements au sol, les petits pas qui rattrapent en saccade un corps qui joue sa fragilité, qui feint d’être au bord de l’effondrement, caractérisent en extrême Asie une manière de manifester son anatomie qui n’a rien de ridicule ou de balourd mais, au contraire, se trouve teinté du caractère kawaii, fragile, doux, enfantin peut-être, mais assurément féminin et qui saura inspirer le désir…
On pourrait imaginer que les kimonos pesants des oirans du Yoshikawa, leurs getas trop lourdes, trop hautes, trop peu fixées furent la cause d’une démarche impliquant une caresse chtonienne permanente, un contact constant au sol de la voute plantaire qui veillerait à ce que le corps ne soit pas emporté avec ses parures. Mais comment comprendre alors l’homographie si forte qu’il y a avec les figures féminines (parfois bien peu vêtues) présentes dans les manga modernes ? Ce qui rend aujourd’hui dans le monde entier immédiatement reconnaissable « le style manga », indépendamment du trait et des dessins, c’est un catalogue de postures connues et dénommées « à la japonaise » par les fans. Une homographie, et un invariant séculaire, – le même que celui saisi par l’objectif de Claude Estèbe.
En amont des femmes dessinées, actuelles ou passées, celles que l’on croise sur l’archipel donc. Et jusqu’aux gyarus, célèbres à Shibuya pour l’extravagance de leur style d’habillement tout autant que pour leur manière d’être. Tout en s’arrachant à ce qu’elles considèrent comme le poids de traditions (vestimentaires autant que comportementales) elles continuent le jeu, sur leurs talons aiguilles et dans leurs mini-jupes provocantes, et se tiennent d’une façon qui reproduit singulièrement les images qui nous ont été laissées par le monde d’Edô.
Dans un pays où la contrainte géographique des catastrophes naturelles en tout genre aura imposé une esthétique autant qu’un style de vie de l’éphémère, on peut voir, au-delà de l’immédiatement visible, une façon d’être qui ne change pas. Malgré la frénésie urbaine et postmoderne de ses mégalopoles, le Japon d’aujourd’hui nous offre un espace privilégié pour comprendre ce qu’est un invariant culturel. Claude Estèbe le saisi à vif et l’offre au spectateur qui saura le voir dans cette exposition.
Olivier Massé, 22 avril 2010
Contacter Olivier Massé